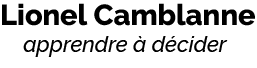Les premiers audits de début de mandat sont en train de sortir. Trop souvent il s’agit uniquement d’un outil utilisé par les nouveaux exécutifs récemment élus pour critiquer la gestion passée. Plus qu’un outil politique, l’audit de début de mandat doit être un réel outil de gestion.
L’audit de début de mandat devrait être réalisé par tous les exécutifs en place afin d’évaluer et de jauger les marges de manœuvre, et de connaître précisément les capacités financières à l’échéance du mandat. L’audit doit permettre de dresser une prospective et de simuler les différents scénarios permettant de définir les dates des principaux investissements et le moment de l’éventuelle croissance de ressources nécessaires à leur réalisation. Trop de collectivités raisonnent uniquement à l’échéance du budget annuel (qu’elles votent bien souvent en avril alors que l’année est déjà bien entamée !). C’est en opposition avec toute notion de bonne gestion. Dans une entreprise, un nouveau projet, un nouvel investissement ou un nouveau business donnent lieu à business plan offrant une vision financière prévisionnelle sur les années à venir.Dans les mairies, il en est de même, seule une vision prospective doit permettre de gérer efficacement 6 années de mandat qui passent très rapidement.
À l’instar de la standardisation ayant métamorphosé le monde industriel au début du siècle dernier, le développement des ERP a engendré de profondes mutations organisationnelles dans l’entreprise. Après le travail des ouvriers, c’est celui des managers qui a été bouleversé remettant en question l’essence de leur travail.
Rentré chez lui après une journée de labeur, il continue inlassablement et infatigablement à répéter le même geste qu’il effectue quotidiennement sur la ligne de montage de l’usine dans laquelle il travaille. L’image de Charlot dans Les temps modernes, vissant à un rythme effréné tel un automate les écrous qui transitent devant son poste de travail est bien connue. Satire des conditions de vie des ouvriers caractéristiques de la première moitié du XXe siècle, elle illustre parfaitement la métamorphose organisationnelle des usines induite par la standardisation.
L’industrialisation, ses fortes cadences, et la standardisation des tâches à outrance ont irrémédiablement dévalorisé et démotivé nombre d’ouvriers.
L’un des principaux enjeux du management a dès lors été de motiver les ouvriers et de les impliquer dans les travaux qu’ils effectuaient : rappelons que les termes management et manager ont été canonisés par Taylor dans Les principes scientifiques du management publié en 1911, faisant référence aux personnes dont le rôle est de motiver les autres personnes à produire. La racine du mot provient du latin manus signifiant « la main », ce qui implique une idée de direction et de commandement, mais provient également du terme « ménage » sous-entendant la conduite efficiente du foyer.
Durant les deux dernières décennies, un phénomène identique à celui qui avait touché le monde ouvrier a métamorphosé à son tour le travail des managers. Cette standardisation du travail des managers s’est produite de manière concomitante avec la standardisation des tâches administratives, le travail des fameux « cols blancs ». Les ERP (Enterprise Resource Planning), appelés en français « progiciels de gestion intégrée », ont été le cadre normalisateur de la standardisation du travail des managers.
Toutefois la dénomination anglaise est significative, car elle met en avant le rôle de planification des ressources que jouent ces logiciels, c’est-à-dire de détermination et de normalisation des tâches individuelles. Véritables carcans, les ERP ont imposé les règles et les procédures desquelles il est totalement impossible de dévier.
C’est ainsi que grand nombre de managers, abandonnant l’aspect analytique qui constituait l’essence même de leur travail de « direction », se bornent aujourd’hui à de la restitution de données via des modèles (fameux templates) préformatés qui exemptent les individus d’un effort dispendieux de réflexion, mais qui surtout offrent aux directions un cadre uniformisé rassurant étant donné que les concurrents, soumis aux mêmes règles, ne peuvent dès lors pas en tirer des avantages compétitifs.
La conséquence de cette standardisation est double : d’une part elle dispense les managers de réflexion, ce qui les empêche de fait d’avoir à la fois la maîtrise et le contrôle des informations restituées, d’autre part elle emprisonne les directions dans des cadres cognitifs qui – imposés par les fabricants de logiciels – sont dès lors les plus rependus et détournent de toute innovation.
C’est ainsi que grand nombre d’entreprises ne réfléchissent plus aujourd’hui leur stratégie en termes de ressources et compétences à leur disposition en vue d’atteindre un nouvel objectif, mais plutôt en termes de capacité et de flexibilité du système d’information à intégrer des changements organisationnels : les systèmes d’informations sont devenus les carcans incontournables des entreprises.
Alors que les tâches demandées aux managers se bornent à l’application de procédures strictes et précises ainsi qu’ à la bonne alimentation du système afin de permettre l’édition de tableaux de pilotages qui sont devenus de véritables icônes divinatoires érigée quotidiennement pour guider l’entreprise, nombreux sont ceux qui ont senti leur fonction dénaturée, leur place au sein de l’organisation altérée, et le sens de leur travail envolé.
Depuis une décennie, accentués par le développement des entreprises du net, de nouveaux modes de management ont émergé transformant profondément les relations interindividuelles et hiérarchiques au sein de nombreuses organisations. Un exemple est l’apparition de la ludification qui tend à transformer les espaces communs de l’entreprise en un espace de détente et de divertissement.
Si l’existence de tels espaces peut certainement accroître les velléités d’un jeune diplômé de rejoindre l’entreprise (ébahi de voir que l’on peut jouer à la console sur le lieu de travail), constituent-ils un réel outil de management ?
Que l’on prenne la société informatique Linkbynet qui a installé un toboggan et des jeux, ou encore certains géants du web tels que Google, Yahoo! ou certains cybermarchands qui ont des consoles de jeux vidéo au sein des espaces communs, on peut raisonnablement se poser la question de l’utilité et de la pertinence de tels équipements en termes de management. L’idée sous-jacente à l’installation de ces équipements est que les moments de détente favoriseront les moments de travail intense.
Ne serait-ce pas uniquement un moyen pour les entreprises de véhiculer une image et ainsi revendiquer leur côté « fun » et amusant ? Pourtant, l’utilité de moments extra-professionnels de détentes et de connivences entre salariés ne fait plus de doute, car ils contribuent à forger un esprit d’équipe. Pour preuve, le développement des « team building » et autres événements qui permettent de resserrer les liens entre salariés. De plus, il est bien connu que l’implication du salarié est garantie par un environnement de travail agréable (théorie de l’implication), tandis que la productivité est favorisée par des moments de détente et de repos. Toutefois, ces moments de détente doivent-ils être apportés par la ludification ?
Celle-ci pose différents problèmes :
1) La réticence des salariés subalternes à utiliser les équipements ludiques mis à disposition par l’entreprise. En effet, inévitablement ils s’interrogeront : « Que va penser mon chef ? » Si cette interrogation est moins vraie dans les TPE et PME dans lesquelles les relations sont souvent plus étroites (voir amicales), cela est bien réel dans les grands groupes où les relations restent dans tous les cas hiérarchisées.
2) Dès lors, les personnes qui utilisent volontiers ces installations sont celles qui ne se posent pas ce type de question. Ayant travaillé pour une grosse entreprise du net, j’ai ainsi pu observer pendant longtemps les directeurs Achat et Commerce disputer leurs parties quotidiennes de jeux vidéo ; les deux directeurs étaient parmi les seuls à utiliser ces équipements en journée (les simples salariés étaient beaucoup plus enclins à les utiliser le soir après 20 h). La fréquence d’utilisation des équipements était inversement proportionnelle au niveau hiérarchique dans l’entreprise.
3) La conséquence a bien souvent été un effet contre-productif du fait d’une démotivation de certains employés : en effet, l’utilisation des jeux vidéo a été source de tensions, notamment chez certains employés soumis à des pressions (comme les commerciaux qui doivent atteindre leurs objectifs). Voir certains de leurs collègues ou leurs supérieurs prendre du bon temps alors qu’eux-mêmes ne parvenaient pas atteindre leurs objectifs a contribué à créer des tensions.
Si la ludification a sans aucun doute des aspects positifs, il s’agit de son intégration au sein des zones de travail qui doit être réfléchi. Il apparaît nécessaire d’installer les équipements dans des lieux adéquats (et non dans les espaces communs de passage), et de sensibiliser les managers sur l’utilisation de ceux-ci comme outils de management. Dans tous les cas, cela peut être un moyen efficace de tisser des liens et d’avoir des discussions informelles (la pause « clope » était auparavant bien utile à ce type de discussion) pour un manager qui peut régulièrement convier certains membres de ses équipes à des parties communes.

Tiraillées entre l’aspect pratique qui fût la clé de leurs succès et la nécessité d’investir dans la recherche, critère de référence des standards internationaux, les grandes écoles sont aujourd’hui à une phase stratégique de leur évolution. Des choix s’imposent, si elles ne veulent pas aller à leur perte.
Le système des grandes écoles françaises s’est construit sur l’aspect fondamentalement pratique de l’enseignement qui y est dispensé. Fondée au XIXe siècle, l’une des plus prestigieuses, l’école des Ponts et chaussées, n’avait aucun enseignant pour encadrer les premières promotions, formées par la confrontation directe au terrain. Cette culture a persisté dans les grandes écoles grâce à la formation par des praticiens, acteurs du terrain, faisant face quotidiennement aux problématiques que les étudiants auront à affronter. Cet aspect pratique est la réelle clé de leur succès : alors que les esprits bien faits sont sélectionnés par des concours rigoureux, ceux-ci parviennent aisément à partir de ces anecdotes empiriques à inférer des méthodes et solutions pratiques. Cette méthode se rapproche de la maïeutique chère à Socrate, amenant les étudiants à raisonner par eux-mêmes.
A contrario, le modèle dominant à travers le monde repose sur des fondements théoriques solides qui offrent aux étudiants des cadres de raisonnements que ceux-ci sont amenés à mobiliser en fonction des situations auxquelles ils sont confrontés. Il s’agit bien de ce modèle qui s’impose aujourd’hui.
Depuis une décennie, de nombreuses grandes écoles ont progressivement délaissé leur aspect pratique, recrutant des enseignants centrés sur la recherche et ignorant pour beaucoup les réalités du terrain. Ce choix est le résultat de la confrontation à la concurrence internationale et de la course aux classements internationaux qui sont devenus de véritables oracles fixant l’avenir de celles-ci.
Afin d’exister au sein de ces classements, les écoles sont confrontées au « Publish or perish », expression anglaise soulignant l’impératif de publication auquel est soumis l’ensemble des chercheurs aujourd’hui. Pour être bien classé, il faut publier et donc recruter des chercheurs. Mais un brillant chercheur spécialisé en finance quantitative est-il un bon pédagogue capable d’inculquer les méthodes et le savoir-faire nécessaire aux managers pour être efficace dans sa mission quotidienne ?
Immiscé dans un environnement privilégiant la recherche, les écoles sont inévitablement amenées à se détacher des réalités pratiques qui doivent être replacés au centre de l’enseignement, car seules garantes d’une offre de formation en parfaite adéquation avec les besoins concrets et actuels des entreprises. Aujourd’hui subsistent encore dans les grandes écoles des enseignants recrutés il y a plusieurs décennies après une expérience de management : ils demeurent les pédagogues garants de la qualité de l’enseignement. Mais ces ressources rares tendent à disparaître.
Dès lors, à l’avenir, les grandes écoles n’ont pas d’autre choix que de bien distinguer leurs activités d’enseignements et de recherche avec d’une part des chercheurs experts dans leurs domaines particuliers focalisés sur les publications afin de garantir aux établissements une reconnaissance selon les standards académiques, et d’autre part des praticiens ancrés dans le terrain à même de transmettre leurs expériences afin de garantir une formation qui répondent aux enjeux réels des entreprises.